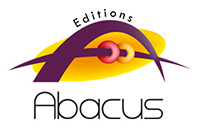Le Système de Condorcet ou le système conventionnel pour nommer les nombres, démarche intuitive ou confuse ? (Annexe C2)

Rappel historique : Le système sexagésimal (base 60) a été inventé en Mésopotamie, il y a plusieurs milliers d’années, et l’on utilisait les phalanges pour compter. Ce système est toujours utilisé pour la mesure des durées, du temps (heures, minutes, secondes) et des angles. Au Moyen âge et à La Renaissance les « Lettrés » ainsi que l’Eglise utilisaient le système romain et le latin qui permettait de compter « régulièrement ». Le peuple ne connaissait que le système sexagésimal qui ne donnait pas de nom au-delà de soixante. La rue a donc adopté des noms simplissimes, de tradition populaire, mais non scientifiques, lorsque le système décimal arabo-indien est arrivé : soixante et dix, quatre-vingt, quatre-vingt et dix, mots qui ne laissent entendre, ni sept, ni huit, ni neuf ce dont les étrangers se gaussent, aujourd’hui ! La lutte entre les abacistes (les lettrés et l’Eglise tenants de l’abaque, romain ou à jetons, et du latin, régulier, pour compter) et les algoristes, tenants du système décimal, des algorithmes de calcul, mais aussi de la mauvaise façon de compter, débutait. Le système décimal permettait de démocratiser les calculs en évitant l’intervention des clercs de l’Eglise. La Révolution a tranché et l’abaque des clercs de l’Eglise a été interdit et avec lui la numération latine régulière. Les algoristes avaient gagné. Condorcet, mort en prison, en 1794, aura eu le temps de mettre en place le système métrique, aujourd’hui système international (1792) ; malheureusement, il n’aura pas eu le temps de diffuser son livre[1] et de rétablir le bon système de numération basé sur le latin.
[1] Condorcet (M), moyens d’apprendre à compter sûrement et avec facilité, première publication en 1799 par sa veuve, Paris, Art-Culture-Lecture, 1989