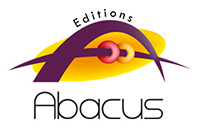Témoignages : apprendre sans comprendre (Annexe C4)
Les témoignages ci-dessous méritent toute notre attention même s’ils prêtent à sourire ; ils montrent que les irrégularités de la numération que l’on impose aux enfants ne passent pas inaperçues dans leur tête.
« Arrête de dire des bêtises, maman »
Maby, 3 ans, interrompt sa maman qui lui apprend à « compter » (04/2021), « Cinquante-huit, cinquante-neuf, soixante, …, soixante-sept, soixante-huit, soixante-neuf, soixante-dix, soixante et onze … » « Arrête de dire des bêtises, maman » …
Cette enfant de trois ans et avec elle tous les enfants francophones de trois, quatre, cinq ans et six ans sont parfaitement lucides. Le système de numération est illogique. Les enfants vont arriver à apprendre sans comprendre, pour la plupart, à surmonter ces « bêtises ». Certains n’y arriveront pas, avant l’adolescence ou l’âge adulte, nous en avons les preuves. Tous garderont une impression de flou et d’incertitude dans ce premier apprentissage.
« C’est encore monsieur le maire ? »
« Maîtresse, pourquoi il n’y a plus de bac à sable ? » « C’est monsieur le maire qui a décidé par mesure d’hygiène ». De retour en classe de calcul, en Grande Section, c’est la comptine « … sept, huit, neuf, … et après ? » « Dix-un, dix-deux, dix-trois ?, … » « Non, on dit « onze, douze, treize, … ». « Pourquoi on dit onze, douze ? » « Cela a été décidé en haut-lieu … » « C’est encore monsieur le maire, maîtresse ? ». Cette anecdote illustre les difficultés de l’apprentissage du nombre que tous les enseignants de l’école primaire connaissent bien.
« Un dix, deux dix, trois dix … »
Une maman qui apprend très tôt à compter à son fils, le fait naturellement en Slovène sa langue d’origine ; le papa français de souche, reprend, plus tard, à quatre ans, la comptine : « … sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, … » L’enfant rectifie alors : on ne dit pas comme ça, papa, on dit « un dix, deux dix, trois dix, … » A l’ordre près, il valide la numération de Condorcet. Tous les enfants français de culture slave, arabe ou asiatique sont confrontés à la même difficulté en passant de leur langue maternelle au français, à l’école. La numération en français, apparaît alors comme étrangement compliquée et fantasque
« 6 014 ou 614 ? … »
Dans un hôpital, une infirmière demande à une jeune aide-soignante de sortir pour lire le numéro de la chambre au-dessus de la porte. Cette dernière revient et affirme 614. Impossible ! A cet étage, les chambres sont numérotées de six mille un à six mille cinquante … L’erreur est une conséquence directe de notre numération conventionnelle, dix, onze, douze, treize, … (608, 609, …, 6014, … à 20 ans ?!?)
« Combien entre 10 et 20 ? … »
… Pour construire un quadrillage orthonormé, je demande à l’élève de 18 ans, combien y-a-t’il (avec des mots simples) entre 10 et 20 ; elle a alors compté sur ses doigts et m’a répondu 8; devant ma surprise elle a recompté et a trouvé 9; étonnement à nouveau, elle a alors annoncé fièrement 10.
« Les adultes d’origine étrangère … »
Giulia témoigne : « … Et pour les nombres once, quinze…. C’est en passant par l’italien, le grec moderne et, plus récemment, l’ukrainien, que ces irrégularités ont été comprises. D’ailleurs, septante, octante et nonante sont plus logiques que soixante-dix, quatre-vingt et quatre-vingt-dix. En italien, settenta, ottenta, noventa. En espagnol, setanta, ochanta, novanta. En ukrainien, chistsat, simsat, vicimsat et deviatsat.
En ukrainien, après déciet, c’est adin (un), nat (dizaine) et tsyat qui veut dire que c’est le nombre après dix. Dvatnatsyat pour douze etc… Pour vingt, dvadtsiat, trente, tritsiat etc…. La seule irrégularité, c’est sorok, qui est quarante. Et pour le cent, c’est sto. Pour le numéro des urgences déminage en Ukraine, c’est stodyn, soit 101. Pour les 1000, j’ai encore du mal mais ça avance.
En passant par les langues étrangères, les irrégularités du français ont enfin été comprises.
…